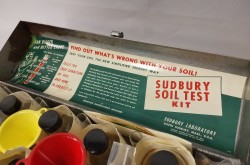Trois choses que vous devriez savoir — Édition de décembre


Rencontrez Renée-Claude Goulet, Jesse Rogerson et Michelle Campbell Mekarski.
Ces trois conseillers scientifiques à Ingenium offrent leurs conseils d’experts sur d’importantes questions d’intérêt pour nos trois musées : le Musée de l’agriculture et de l’alimentation du Canada, le Musée de l’aviation et de l’espace du Canada et le Musée des sciences et de la technologie du Canada.
Dans ce pittoresque blogue mensuel, les conseillers scientifiques d’Ingenium proposent trois faits insolites liés à leur domaine d’expertise. Pour l’édition de décembre, ils se penchent sur la science qui se cache dans votre bière, ils offrent des conseils pour observer la pluie de météores des Géminides et ils fracassent des mythes sur l’alcool que contiennent certaines boissons chaudes du temps des fêtes.

La science est partout, jusque dans votre bière
Le temps des fêtes approche, et pour beaucoup de gens, une ancienne boisson fait partie des réjouissances : la bière. On a trouvé des preuves que les humains fabriquent de la bière depuis 13 000 ans, ce qui est extraordinaire. À titre de comparaison, pensez que l’évolution de notre espèce humaine, Homo sapiens, a débuté il y a environ 200 000 ans, et que la domestication des plantes et des animaux a commencé il y a 12 000 ans.
La bière a elle aussi évolué au fil des époques, et de nos jours, nous concoctons cette boisson à partir d’eau, de levure et de céréales (habituellement de l’orge), auxquelles on ajoute du houblon depuis environ 1079.
Mais qu’est-ce que le houblon, exactement, et pourquoi est-il omniprésent dans la bière que nous consommons de nos jours?
Le houblon, Humulus lupulus, est une plante grimpante vigoureuse dont la taille atteint les 5 à 8 mètres. Cette plante, de l’ordre des Urticales (du latin « urere », qui signifie « brûler »), est couverte de poils hérissés et raides qui irritent la peau. C’est une plante vivace, qui repousse donc chaque année, qui vient des régions tempérées et peut être récoltée après 4 ou 5 mois. Comme son pollen se propage au vent, plutôt que de produire des fleurs qui attireraient les insectes, la plante produit des cônes munis de glandes qui sécrètent une huile. L’huile de houblon contient de nombreux composés. En effet, des scientifiques ont détecté dans un échantillon plus de 110 composés, dont 47 se retrouvent dans la bière. Des travaux de recherche révèlent que les composés de l’huile de houblon agissent d’une multitude de façons sur le processus de brassage, avec une grande variété de résultats. Or deux groupes de molécules occupent une place centrale parmi toutes ces interactions.
Les acides alpha et bêta agissent de deux façons. D’abord, ce sont eux qui donnent à la bière son amertume. Ils en préservent aussi les saveurs et la qualité en la protégeant de l’oxydation, un effet de la lumière, et en empêchant la croissance de micro-organismes indésirables.
Le second groupe, les terpènes, sont des molécules qui donnent ses arômes à la bière. Chaque variété de houblon possède son profile de terpènes. En fait, les brasseurs disposent maintenant d’une multitude de variétés associées à divers arômes : agrumes, fruits, notes florales ou herbacées. Vous ne le saviez peut-être pas, mais le houblon et le cannabis font partie de la même famille : les cannabinacées. Ils partagent de nombreuses caractéristiques et certains composés, comme le linalol, qui produit dans les deux cas un arôme épicé et floral bien caractéristique.
La prochaine fois que vous dégusterez une IPA très amère ou une bière sure aux arômes délicatement fruités, pensez à remercier le sélectionneur ou le producteur de houblon, sans qui toutes ces délicieuses saveurs n’existeraient pas!
Par Renée-Claude Goulet

Voyez comme tous les météores associés aux Géminides pointent vers une même direction bien précise. Ce point est situé dans la constellation des Gémeaux, qui a donné son nom aux météores.
Bientôt visible dans un ciel près de chez vous : la pluie de météores des Géminides
L’une des meilleures pluies de météores de l’année, celle des Géminides, battra son plein les 13 et 14 décembre prochains. Mais qu’est-ce qu’une pluie de météores, et quelle sera la meilleure façon d’observer les Géminides cette année? Voici des réponses à ces questions.
Une étoile filante est un météore, causé par de tout petits fragments de roches qui errent dans l’espace, souvent pas plus gros qu’une petite bille, et qui brûlent en entrant dans l’atmosphère de la Terre. Quand on peut observer plusieurs de ces météores à quelques minutes d’intervalle sur une longue période, on parle de pluie de météores.
La pluie de météores des Géminides provient d’un astéroïde appelé 3200 Phaéthon, un amas rocheux qui mesure 6 kilomètres et dont l’orbite autour du Soleil croise celle de la Terre. Sur son trajet, 3200 Phaéton éjecte une partie de la matière qui le compose, laissant derrière lui une traînée de poussières et de roches. Chaque année, vers la mi-décembre, la Terre traverse cette traînée de résidus, ce qui crée la pluie de météores des Géminides.
C’est lorsque l’obscurité du ciel est maximale que l’on peut le mieux observer les pluies de météores. Malheureusement, cette année, la pluie de météores suivra tout juste la pleine Lune, moment où celle-ci est très lumineuse et visible toute la nuit. Tout de même, malgré la pleine Lune, les Géminides produiront de 20 à 30 météores l’heure!
Si vous comptez observer la pluie de météores, gardez à l’esprit les quelques conseils suivants.
- Trouvez un endroit éloigné des lumières de la ville, comme un parc ou la campagne.
- Prévoyez observer le ciel pendant au moins une heure ou une heure et demie. Les yeux mettent du temps à s’ajuster à la noirceur, et vous ne voudrez sûrement pas limiter votre observation à quelques météores!
- Plus il fait noir, meilleure est l’observation. Prévoyez donc une sortie bien après le coucher du soleil (passé minuit, c’est encore mieux), et à une bonne distance de l’éclairage urbain.
- Amenez vos proches! Vous aurez encore plus de plaisir en partageant cette expérience, et ce sera beaucoup plus sécuritaire.
- Habillez-vous chaudement. Il peut faire froid en décembre, surtout la nuit. Mettez plusieurs épaisseurs, plus en fait que vous ne pensez en avoir besoin. Procurez-vous des chauffe-mains, et glissez-en dans vos bottes et mitaines et sous votre manteau. N’oubliez pas d’enfiler un pantalon de neige et une tuque!
- Apportez un thermos de chocolat chaud, de café ou de thé… et des collations!
- Soyez vigilant : Apportez toujours un téléphone cellulaire et une lampe de poche bien chargés, et informez une personne qui ne vous accompagnera pas de l’endroit où ira votre groupe et pour combien de temps.
Souhaitons-nous un ciel dégagé!
Par Jesse Rogerson

Pendant les fêtes, échauffez-vous l’esprit en réfléchissant aux taux d’évaporation d’un verre de vin chaud.
Alerte aux mythes : boissons chaudes et alcool
Une fois la neige et le froid arrivés, lorsque l’on ne peut plus sortir sans enfiler cinq épaisseurs, rien ne semble plus tentant qu’une boisson chaude additionnée d’un petit « remontant ». Vins chauds, grogs et lattes arrosés d’alcool, les boissons chaudes alcoolisées sont l’antidote parfait à la période la plus froide de l’année.
Mais peut-on prendre le volant après avoir consommé une de ces boissons? Et qu’en est-il des alcools que l’on ajoute aux ragoûts, sauces, pâtisseries et marinades à viandes? D’ailleurs devrait-on même donner aux enfants de ce gâteau au rhum que l’on sert au temps des fêtes? La plupart des gens croient que le plus gros de l’alcool ajouté à une boisson chaude ou à une recette s’évapore (ou se dissipe), ne laissant derrière qu’une saveur subtile ou un arôme délicat.
Alerte au mythe! La chaleur n’a pas autant d’effet sur l’alcool que les emplettes de Noël sur votre porte-monnaie! Dans une étude réalisée en 2007, le département américain de l’Agriculture dévoilait les résultats de tests au cours desquels on vérifiait la quantité d’alcool qu’éliminaient quatre types de préparation : sans chaleur, ajout à un liquide en ébullition, flambé et cuit au four.
Comme on peut l’imaginer, plus la cuisson est longue, plus l’alcool s’évapore. MAIS cette évaporation se produit beaucoup plus lentement que vous ne pourriez le croire. Les molécules d’alcool restent bien attachées aux molécules d’eau que contiennent les boissons et la nourriture. Par conséquent, il n’est pas facile de se débarrasser de l’alcool. La nourriture doit donc être cuite (au four ou en la faisant bouillir) pendant environ 3 heures pour faire disparaître toute trace d’alcool. Une heure de cuisson élimine environ 75 % de l’alcool, 15 minutes en éliminent environ 60 %. Flamber un liquide n’élimine que 25 % de l’alcool, et remuer une boisson chaude dans laquelle on a versé une liqueur élimine seulement 15 % de l’alcool environ.
Conclusion : les cafés pour adultes et les desserts flambés contiennent probablement plus d’alcool que vous ne le croyez. Si vous devez éviter l’alcool pour une raison ou une autre, ne croyez pas qu’un peu de chaleur vous en débarrassera. Par contre, si vous vous inquiétez de perdre environ 15 % de l’alcool que contient votre boisson chaude agrémentée d’un « remontant », voilà une excuse toute trouvée pour y verser une ration supplémentaire.
Par Michelle Campbell Mekarski