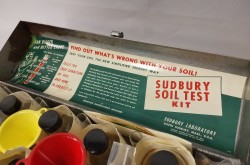Trois choses que vous devriez savoir - Édition de février


faites connaissance avec Renée-Claude Goulet, Jesse Rogerson et Michelle Campbell Mekarski.
Ils sont les conseillers scientifiques d’Ingenium, fournissant des conseils d’experts sur des sujets importants en lien avec nos trois musées, soit le Musée de l'agriculture et de l'alimentation du Canada, le Musée de l'aviation et de l'espace du Canada et le Musée des sciences et de la technologie du Canada. Dans cette divertissante série mensuelle de billets de blogue, les conseillers scientifiques d’Ingenium présentent trois pépites insolites touchant à leur champ d’expertise.
Dans la publication du mois de février, nos conseillers scientifiques nous expliquent la pertinence de l'Année internationale de la santé des végétaux, offrent un aperçu des expériences fascinantes qui se déroulent à bord de la SSI et présentent des images scientifiques saisissantes.

Un éclair coloré : les nerfs et le système vasculaire se côtoient dans cette image, montrant le réseau neurovasculaire de la peau d'une souris. Les neurones (en rouge) guident non seulement la formation de leurs axones, mais aussi les vaisseaux sanguins (en vert) dans un réseau organisé, tandis que de nouveaux vaisseaux se forment à partir des vaisseaux existants, tant au cours du développement qu'à l'âge adulte. Les signaux partagés par les neurones et les vaisseaux peuvent nous aider à concevoir des traitements ciblés contre des maladies telles que le cancer et à créer de nouveaux organes qui soient structurellement et fonctionnellement pertinents (description de l'image par Sila Appak Baskoy).
La puissance des images en science
Notre univers est constitué de nombreux éléments qui ne peuvent être ni vus, ni manipulés, ni même imaginés. Pensez-y en ce moment : Pouvez-vous ressentir la gravité des soleils lointains? Pouvez-vous voir les électrons qui vous entourent? Regardez votre peau; pouvez-vous voir la couche de bactéries qui vous recouvre? Nous ne pouvons rien voir ni sentir de tout cela! Et pourtant, parce que nous comprenons la théorie de la gravité, nous pouvons également comprendre le mouvement des planètes. Le fait de pouvoir prédire le comportement des électrons nous permet d'alimenter nos maisons. La connaissance de la reproduction des virus nous aide à combattre et à guérir des maladies. Nous sommes capables d’étonnantes réalisations grâce à la science des éléments que nous ne voyons pas.
Aussi impressionnant que cela puisse paraître, il est difficile d'expliquer et de partager des choses que nous ne pouvons même pas imaginer! L'humain est une créature extrêmement visuelle. Une grande partie de notre cerveau est consacrée au traitement visuel qui nous permet de traiter, d'analyser et d'apprendre rapidement à partir d'images (bien plus rapide que la lecture!). Les images attirent plus facilement notre attention (avez-vous regardé l'illustration ou le texte en premier lorsque vous avez commencé à lire cet article?)
Les images contribuent également à rendre les faits plus personnels. Souvent, les découvertes scientifiques, même les plus importantes, ne nous semblent tout simplement pas pertinentes ou importantes en tant qu'individus. Nous pouvons ne pas nous sentir préoccupés par une maladie particulière parce qu’elle ne nous concerne pas émotionnellement. La découverte d'une nouvelle étoile peut ne pas nous intéresser parce qu'elle ne fait pas partie de notre vie quotidienne. Les images nous aident à nous intéresser à la science, à la rendre réelle et importante.
C'est peut-être pour cette raison que l'un de mes articles scientifiques en ligne préférés, chaque année, est le concours Science Exposed organisé par le Conseil de recherches en sciences naturelles et en génie du Canada (CRSNG). Les scientifiques soumettent une illustration et un court texte qui sont évalués par les membres d'un jury et le public. La candidature est évaluée selon la beauté, la valeur de la recherche et la qualité émotionnelle de l’image, tout en tenant compte de la description.
Parmi les finalistes de l'édition 2019, mon coup de cœur est une illustration des nerfs et des vaisseaux sanguins de la peau d'une souris. Visuellement, c'est assez frappant. Les vaisseaux sanguins (en vert) et les neurones (en rouge) traversent l'image comme une sorte d'éclair extraterrestre fluorescent. Sur le plan scientifique, il est également intéressant de constater que ces deux systèmes se développent presque en parallèle, car ils sont déclenchés par les mêmes signaux. Il est important de noter que ce type de recherche pourrait aider les scientifiques à développer des traitements pour des maladies et à faire croître des organes de substitution.
La science peut être étonnante, dégoûtante, inattendue et même révélatrice. Elle est également vitale, inédite et en constante évolution. Il suffit souvent d'une illustration pour s'en souvenir.
Par Michelle Campbell Mekarski

L'oïdium (en blanc) et la rouille jaune (en jaune-orange) sont des maladies fongiques qui affectent le blé, un aliment de base, et réduisent considérablement les récoltes.
L'Année internationale de la santé des végétaux : pourquoi est-ce si important et comment pouvons-nous contribuer?
Produisant près de 98 % de l'oxygène que nous respirons et la plupart des aliments que nous consommons (ou la nourriture pour les aliments que nous mangeons), il est indéniable que les végétaux sont essentiels à notre survie. Mais, tout comme nous, les végétaux peuvent être malades. Cela peut avoir des répercussions dévastatrices sur nos systèmes alimentaires et sur notre capacité à nourrir une population croissante. C'est pourquoi les Nations Unies ont déclaré 2020 l'Année internationale de la santé des végétaux, une année consacrée à la nécessité urgente de « protéger les végétaux, protéger la vie ».
Les principales causes nuisibles à la santé des végétaux sont les maladies et les parasites qui attaquent et affaiblissent autant les plantes sauvages que domestiques. Ceux-ci provoquent des pertes énormes pour nos systèmes agricoles, réduisant considérablement la qualité et la quantité des aliments cultivés. L'Organisation pour l'alimentation et l'agriculture estime que les parasites et les maladies sont responsables de la perte de 40 % des aliments cultivés à l’échelle mondiale chaque année. Il s'agit d'un problème croissant, l'augmentation des voyages et du commerce internationaux a favorisé une propagation plus rapide et plus importante des maladies et des parasites. Les activités humaines et les changements climatiques perturbent les interactions entre les écosystèmes, ce qui favorise leur développement.
Nous n'avons pas besoin de chercher bien loin pour trouver des exemples de la façon dont un piètre état des végétaux peut menacer notre sécurité alimentaire ou notre mode de vie. En 1845, la Grande famine en Irlande a été déclenchée par le mildiou, une maladie fongique qui a décimé les récoltes de pommes de terre pendant plusieurs années, anéantissant un aliment de base et causant, selon les estimations, près d'un million de décès dus à la famine. Actuellement, la rouille du café, une autre maladie fongique, sévit dans les exploitations agricoles de toutes les régions productrices de café, ce qui constitue une véritable menace pour cette culture et les moyens de subsistance des caféiculteurs.
Étant donné l'importance de la santé des végétaux pour la sécurité alimentaire, le développement économique et l'environnement, nous sommes tous appelés à passer à l'action. Mais que peut faire un citoyen moyen pour contribuer à la santé des végétaux? La prévention étant le meilleur des remèdes, des gestes simples comme ne pas déplacer les végétaux et la terre au-delà des frontières (par exemple par courrier ou dans une valise) et détruire les plantes malades dans son jardin peuvent avoir un impact important. L'ONU a même mis à disposition un contenu gratuit pour les médias sociaux que chacun peut partager pour s'engager, s’informer ou simplement appuyer cet effort collectif! Bonne année internationale de la santé des végétaux à tous!
Par Renée-Claude Goulet

Ces trois chercheurs de la University of Colorado tiennent les contenants de bactéries et de champignons qui seront envoyés sur la SSI.
La science dans l'espace
La Station spatiale internationale (SSI) est l'une des installations les plus impressionnantes que l'humanité ait jamais construites. Elle tourne autour de la Terre à une vitesse de plus de 28 000 km/h, à une hauteur d'orbite de 400 km. Les cinq agences partenaires qui l'ont créée (NASA, ROSCOSMOS, CSA, JAXA et ESA) ont commencé sa construction en 1998 et l'ont terminée en 2009. Elle est aujourd'hui aussi grande qu'un terrain de football!
Mais que se passe-t-il exactement là-haut? La SSI assure une présence humaine continue depuis près de 20 ans, alors qu'est-ce que ces astronautes ont accompli là-haut pendant tout ce temps? Il s'avère que... beaucoup.
La SSI est un immense laboratoire qui se penche régulièrement sur des questions liées à la façon dont les humains vivent et travaillent dans l'espace. Un grand nombre d'expériences scientifiques sont en cours à la SSI, dont six sont menées par des chercheurs canadiens. La science en développement sur la SSI provient de plusieurs domaines de recherche différents : biologie et biotechnologie, sciences de la Terre et de l'espace, activités éducatives, recherche sur l'humain, sciences physiques, et technologie.
Ainsi, depuis le début de janvier 2020, une expérience est en cours sur la SSI; il s'agit du projet Space Biofilms. Un biofilm est une communauté de microbes qui se sont liés les uns aux autres et qui sont capables de se fixer et de se répandre sur diverses surfaces. S'il n'est pas contrôlé, un biofilm peut se répandre sur des surfaces et provoquer des défaillances (comme dans un ordinateur ou un système de sécurité important à bord de la SSI). Il est donc essentiel que les scientifiques, les ingénieurs et les astronautes comprennent comment les microbes réagissent à bord de la SSI afin de rendre les vols spatiaux plus sécuritaires à l’avenir, en particulier lors de missions de longue durée vers la Lune ou Mars.
Lors de l'expérience de Space Biofilms, les chercheurs sur place ont envoyé des contenants de microbes congelés qui ont été par la suite décongelés dans l'espace par les astronautes. Après le développement et la propagation dans les contenants, ils ont été retournés sur Terre où les chercheurs peuvent maintenant analyser les résultats.
Il ne s’agit que d’une des nombreuses expériences qui ont eu lieu à bord de la SSI, où ces scientifiques hautement qualifiés travaillent à des kilomètres au-dessus de nos têtes pour rendre la vie et le travail plus sécuritaire et simple dans l'espace.
Par Jesse Rogerson